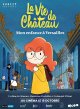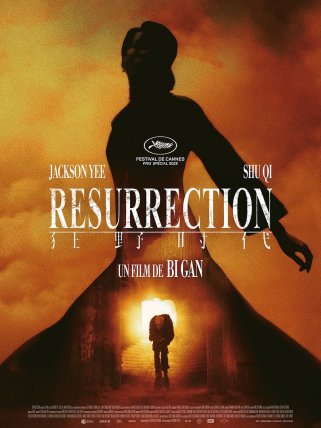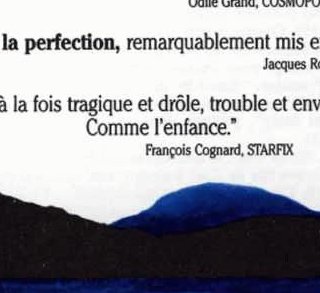Le 30 décembre 2021
Grand succès à sa sortie, le diptyque de Claude Berri révéla les talents dramatiques de Daniel Auteuil. Pour le reste, les deux films constituent le prototype de cette qualité française, si empreinte d’académisme.

- Réalisateur : Claude Berri
- Acteurs : Emmanuelle Béart, Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Yves Montand, Hippolyte Girardot, Margarita Lozano, Ticky Holgado, Fransined, Elisabeth Depardieu, Didier Pain, André Dupon, Jean Bouchaud
- Genre : Drame, Téléfilm, Remake
- Nationalité : Français
- Distributeur : Pathé Distribution, AMLF Distribution
- Editeur vidéo : Pathé Vidéo
- Durée : 2h21mn (Jean de Florette) - 1h53mn (Manon des Sources)
- Date télé : 30 décembre 2021 21:05
- Chaîne : France 3
- Reprise: 20 septembre 2017
- Box-office : Jean de Florette 7.223.657 entrées France / 676.843 entrées Paris Périphérie - Manon des Sources : 6.645.177 entrées France / 592.133 entrées P.P.

L'a vu
Veut le voir
– Date de sortie de Jean de Florette : 27 août 1986
– Date de sortie de Manon des Sources : 19 novembre 1986
Résumé : Dans un petit village de Haute Provence, Jean de Florette vient s’installer sur le terrain dont il vient d’hériter et rêve à de merveilleuses cultures. Mais Ugolin a lui aussi un projet pour ce terrain : y faire pousser des œillets. Le vieil oncle Papet va l’y aider...
Critique : Tiré du récit L’Eau des collines, de Marcel Pagnol, adapté par son auteur lui-même en 1986 (avec Jacqueline Pagnol et Rellys), le diptyque Jean de Florette/Manon des Sources connut un très grand succès en 1986, puisque près de 14 millions de Français plébiscitèrent la grande fresque de Claude Berri. Trois ans de tournage, quelques stars pour attirer le public (Montand et Depardieu), deux révélations de la jeune génération (Auteuil et Béart), le défection d’un certain Coluche : les deux films de Claude Berri suscitèrent, à l’époque, un certain nombre de commentaires qui n’avaient pas forcément de rapport avec la qualité cinématographique de cette fiction. Car si cette histoire typiquement pagnolesque, qui mélange la tragédie des Atrides (pour l’infanticide) avec Le Comte de Monte-Cristo (pour la vengeance de Manon) se laisse regarder, on ne peut pas dire que la Provence, dont la majesté est saisie par la pellicule, ne soit pas réduite à quelques caricatures d’autochtones au verbe haut, à la faconde exotique.
Dans le rôle-titre, Auteuil est évidemment une révélation, offrant un contre-emploi saisissant, lui qui avait enchaîné des comédies médiocres pendant quelques années : le niais Ugolin qu’il incarne, sous l’emprise de son oncle machiavélique, sera un tournant de sa carrière. La prestation lui valut le César du meilleur acteur en 1987.
Montand, quant à lui, trouvait dans "le Papet" le dernier grand emploi de son parcours cinématographique : tantôt paternaliste, tantôt chafouin, il se fige dans des postures pathétiques, dès lors que la vérité terrible éclate, tandis que Berri enchaîne des scènes de plus en plus académiques, jusqu’à la mort.
Depardieu n’apparaît que dans le premier volet, le temps que son personnage vive un rêve devenu cauchemar, puisque la propriété qu’il acquiert dépérit sous le double effet de la sécheresse et d’une source bouchée, pour des histoires de rancune villageoise. Emmanuelle Béart joue une sauvageonne qui n’a que sa beauté à proposer : elle lorgne vaguement sur Adjani, lors de la célèbre scène de dénonciation devant tout le village réuni, après le sermon comminatoire du curé. Pas de quoi pavoiser. Mais cela enchanta tout de même "les professionnels de la profession", qui lui attribuèrent le César de la meilleure actrice dans un second rôle, l’année suivante.
Si le récit a la cruauté des grandes nouvelles de Maupassant, on ne peut pas dire que Berri, artisan d’un cinéma académique, ait fait preuve d’une grande audace formelle, en le transposant sur grand écran : les deux films sont calibrés pour un public très large, avec une succession classique de scènes réalistes et d’acmés diégétiques destinées à retenir l’attention. C’est de la belle ouvrage, comme on dit d’un objet vaguement ennuyeux, qui lorgne sur les récompenses officielles.
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.